 Je ne sais trop quelle prétention ou quelle lassitude se cache derrière l'idée fascinante d'une destruction massive par une soudaine apocalypse. Peut-être s'agit-il de la réaction de culpabilité inhérente à toute civilisation lorsqu'elle prend vaguement conscience du leurre que constitue son "contrat social". Je pense cependant qu'une telle notion est intimement liée aux croyances sur l'après-vie et que l'action sur la pensée de l'attracteur étrange du cataclysme affecte essentiellement les sociétés à paradis. Quel sens aurait-il dans un système védantiste à réincarnations ?
Je ne sais trop quelle prétention ou quelle lassitude se cache derrière l'idée fascinante d'une destruction massive par une soudaine apocalypse. Peut-être s'agit-il de la réaction de culpabilité inhérente à toute civilisation lorsqu'elle prend vaguement conscience du leurre que constitue son "contrat social". Je pense cependant qu'une telle notion est intimement liée aux croyances sur l'après-vie et que l'action sur la pensée de l'attracteur étrange du cataclysme affecte essentiellement les sociétés à paradis. Quel sens aurait-il dans un système védantiste à réincarnations ?Je reviens brièvement sur ce sujet - assez peu intéressant en soi, je l'admets - pour évoquer une actualité récente qui servira d'exemple utile à un article précédent. En effet, s'il n'y a pas plus important qu'une apocalypse en instance, il n'y a pas non plus d'événement aussi vite oublié. Il est impossible aujourd'hui de retrouver la date à laquelle ma mère et ses amies, alors enfants, attendirent toute la nuit, terrorisées dans leur chambre, à la lueur d'une chandelle, la fin du monde ; le Christ de Montfavet - Georges-Ernest de son prénom - l'avait prédite à la radio. Ce devait être au début des années 50. Une douzaine d'Armageddons plus tard, on se souvient à peine de la populaire éclipse solaire d'Août 1999, celle du fameux Nostradamus : nous avions alors le choix entre une troisième guerre mondiale, une planète asséchée, un renversement des pôles ou, en désespoir de cause, la chute d'une petite station orbitale. Me défiant donc de la mémoire de mon lecteur, je préfère lui rappeler ici la dernière apocalypse en date.
Il y a quelques jours, un hurluberlu annonçait pour le 25 Mai 2006 la chute d'un fragment de comète dans l'Atlantique. Le déferlement d'un tsunami de deux cents mètres de haut devait ravager les côtes de la Floride jusqu'au Portugal. Au Maroc, la rumeur atteignit des proportions telles que les autorités durent la démentir. Néanmoins, de nombreux habitants des villes portuaires de Rabat, Casablanca, Agadir et Tanger se réfugièrent à la campagne. La nuit même de la catastrophe annoncée, la panique éclata à Rabat : réveillés par des explosions, les habitants sortirent dans les rues. Vérification faite, c'était un feu d'artifice dans le quartier voisin.
L'affaire du "tsunami marocain" :
Article de l'Economiste, 23 Mai 2006 : Tsunami ? Souriez, vous êtes piégé !
Article du Nouvel Observateur, 23 Mai 2006 : Folle rumeur de tsunami au Maroc.
Article de l'Opinion, 26 Mai 2006 : Panique la veille du « tsunami ».
 Allez zou ! Un petit article pour vous faire croire que j'ai passé ma semaine à tout autre chose qu'arpenter la campagne en VTT.
Allez zou ! Un petit article pour vous faire croire que j'ai passé ma semaine à tout autre chose qu'arpenter la campagne en VTT.

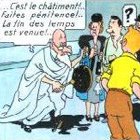 Si l'on considère que la mémoire de l'humanité se résout en celles des individus qui la composent, assurément elle ne dépasse pas les dix ans. Dans ces conditions d'amnésie générale, l'instauration d'un nouveau pouvoir totalitaire, l'explosion d'une autre guerre mondiale, l'horreur d'un prochain génocide, non seulement sont inévitables, mais encore seront accueillies avec joie.
Si l'on considère que la mémoire de l'humanité se résout en celles des individus qui la composent, assurément elle ne dépasse pas les dix ans. Dans ces conditions d'amnésie générale, l'instauration d'un nouveau pouvoir totalitaire, l'explosion d'une autre guerre mondiale, l'horreur d'un prochain génocide, non seulement sont inévitables, mais encore seront accueillies avec joie. Si l'on me demandait quel phénomène de la conscience je trouve le plus bizarre, le plus intrigant, le plus mystérieux, sans hésitation je répondrais : la mémoire. Elle est une évidence à tout le monde ; on la suppose retranscrire fidèlement les événements révolus et nul ne doute qu'elle accomplisse avec zèle son labeur honnête de mineur des galeries obscures du passé. Aussi n'y aurait-t-il pas, à première vue, grand'chose à dire à son propos.
Si l'on me demandait quel phénomène de la conscience je trouve le plus bizarre, le plus intrigant, le plus mystérieux, sans hésitation je répondrais : la mémoire. Elle est une évidence à tout le monde ; on la suppose retranscrire fidèlement les événements révolus et nul ne doute qu'elle accomplisse avec zèle son labeur honnête de mineur des galeries obscures du passé. Aussi n'y aurait-t-il pas, à première vue, grand'chose à dire à son propos. Un des traits les plus drolatiques du faux scepticisme est son inépuisable capacité à fournir des explications "rationnelles" plus irrationnelles et plus incohérentes encore que les superstitions qu'il prétend combattre. Je me rappelle quelques objections au témoignage de personnes affirmant avoir observé ensemble des bonnes vierges ou des petits hommes verts : il s'agirait d'un phénomène d'hallucination collective. Par malheur, je doute que la psychiatrie ait jamais recensé de délire connu sous ce nom. En tous cas, il n'est pas mentionné dans le DSM-IV. Idem, si certaines prédictions se réalisent, ce serait parce que le consultant a été influencé inconsciemment. Il faut d'abord remarquer que les mêmes sceptiques pourront s'opposer ailleurs à la notion d'inconscient qu'ils utilisent ici ; ensuite, cette opinion n'est qu'une variante de la superstition païenne confondant prédire un événement et jeter un sort. En bref, tout ce qui semble dévier tant soit peu de la convention la plus banale est rejeté sans analyse, "expliqué" par des arguments de comptoir ou classé dans le vaste dossier des "illusions cognitives encore inconnues".
Un des traits les plus drolatiques du faux scepticisme est son inépuisable capacité à fournir des explications "rationnelles" plus irrationnelles et plus incohérentes encore que les superstitions qu'il prétend combattre. Je me rappelle quelques objections au témoignage de personnes affirmant avoir observé ensemble des bonnes vierges ou des petits hommes verts : il s'agirait d'un phénomène d'hallucination collective. Par malheur, je doute que la psychiatrie ait jamais recensé de délire connu sous ce nom. En tous cas, il n'est pas mentionné dans le DSM-IV. Idem, si certaines prédictions se réalisent, ce serait parce que le consultant a été influencé inconsciemment. Il faut d'abord remarquer que les mêmes sceptiques pourront s'opposer ailleurs à la notion d'inconscient qu'ils utilisent ici ; ensuite, cette opinion n'est qu'une variante de la superstition païenne confondant prédire un événement et jeter un sort. En bref, tout ce qui semble dévier tant soit peu de la convention la plus banale est rejeté sans analyse, "expliqué" par des arguments de comptoir ou classé dans le vaste dossier des "illusions cognitives encore inconnues". Mon excellente amie Lolotte, dont le génie critique ne saura jamais assez être surestimé, se gausse vivement de l'usage, fautif selon elle, de malgré que dans mon article précédent. Après vérification, je maintiens ce que je lui affirmai déjà lors de notre dernière rencontre : malgré que était d'usage courant dans le Français classique (XVIIe siècle) et continue d'être utilisé. Certes il fait partie du registre soutenu mais c'était justement le propos de ce billet au style pédant et affecté.
Mon excellente amie Lolotte, dont le génie critique ne saura jamais assez être surestimé, se gausse vivement de l'usage, fautif selon elle, de malgré que dans mon article précédent. Après vérification, je maintiens ce que je lui affirmai déjà lors de notre dernière rencontre : malgré que était d'usage courant dans le Français classique (XVIIe siècle) et continue d'être utilisé. Certes il fait partie du registre soutenu mais c'était justement le propos de ce billet au style pédant et affecté.